Recherche
15318 résultats correspondent à votre recherche.
CFIM TP
87 410 Le Palais-sur-Vienne
T. 05 55 04 03 83
CFIM TP est également présent à La Souterraine
Pour effectuer une demande de formation :
- Salariés d'entreprises > le service RH de son employeur
- Salariés en reconversion > le service RH, le FONGECIF ou la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
- Travailleurs intérimaires > se rapprocher de son agence d'intérim
- Demandeurs d'emploi > Pôle Emploi ou la Mission Locale pour les - de 26 ans
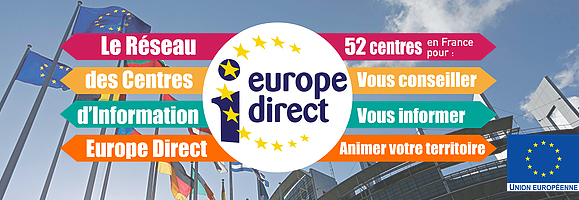
Depuis la grande terrasse sur le toit, le regard embrasse les bords de Charente. Des rives naturelles préservées, un patrimoine de grande qualité : Saintes, ville d'Art et d'Histoire, Port d'Envaux, village de pierre et d'eau… Jusque dans les années 50, la Charente servait au transport de marchandises, notamment le sel et les cognacs voisins. Les premières croisières démarrent à partir des années 70 et 80. Natif de la Charente-Maritime, Pascal Duc revient à Saintes après avoir été garde-forestier. Il veut créer son entreprise de navigation sur la Charente et fait l'acquisition en 2009 du Bernard Palissy II, déjà en activité. Mais le navire pèse 67 tonnes d'acier et fonctionne avec un moteur diesel de 230 chevaux ! Pascal Duc veut créer un bateau plus respectueux de l'environnement, capable de transporter 150 passagers avec le maximum de confort. « Une propulsion électrique était envisageable car la Charente est un fleuve calme. »





