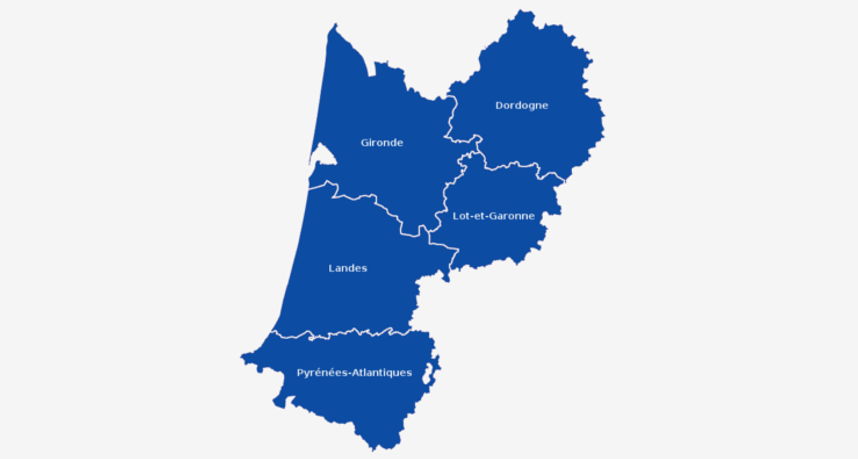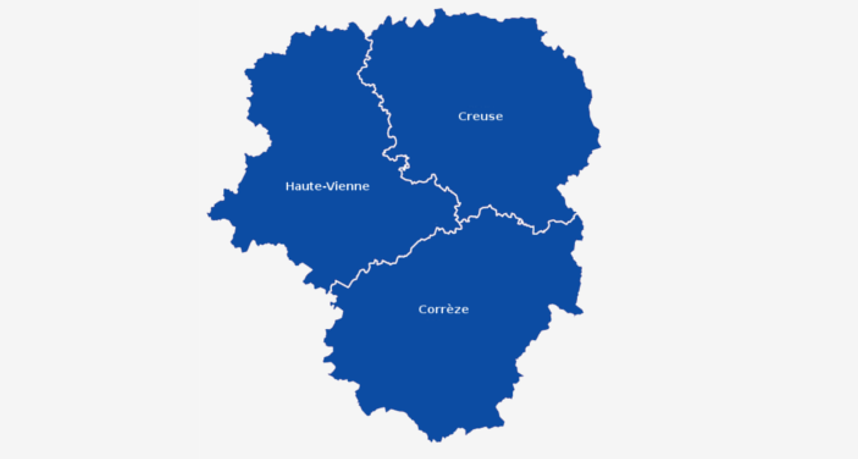Recherche
15929 résultats correspondent à votre recherche.
2016
FEDER - FSE10 mars |
FEADER7 février |
2015
FEDER - FSE22 mai |
FEADER29 avril
|
Les autres programmes régionaux européens
Quels types de projets peuvent être aidés sur les programmes 2014/2020?
*Aides européennes gérées par la Région Nouvelle-Aquitaine selon le territoire concerné